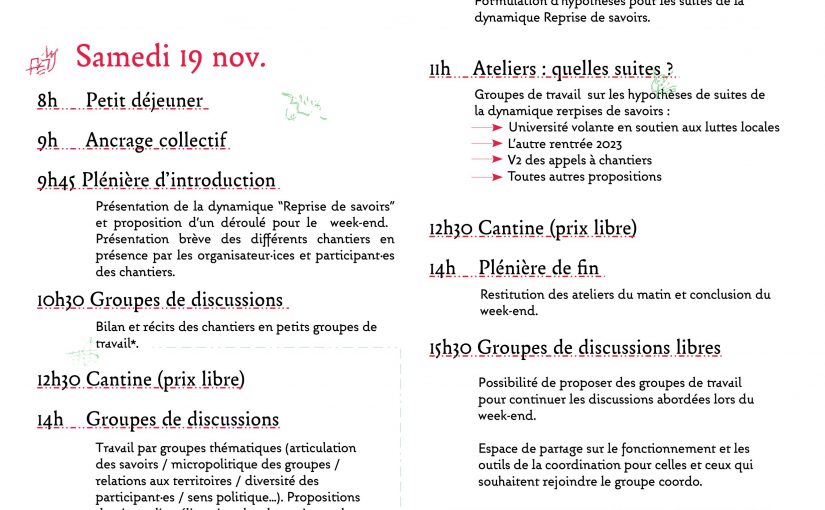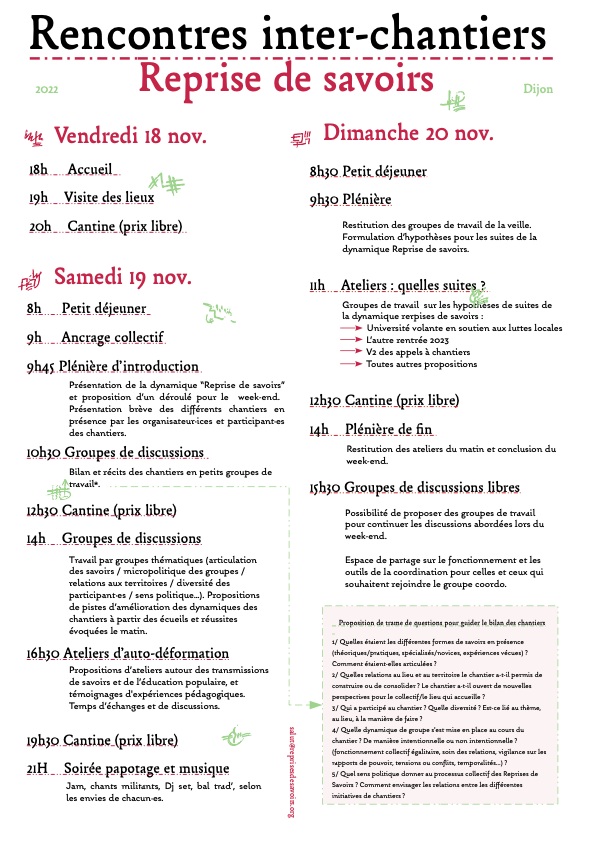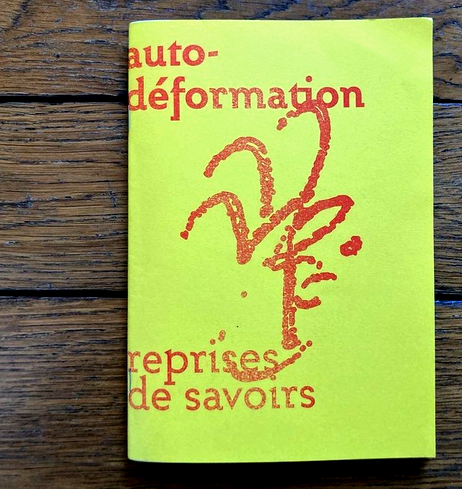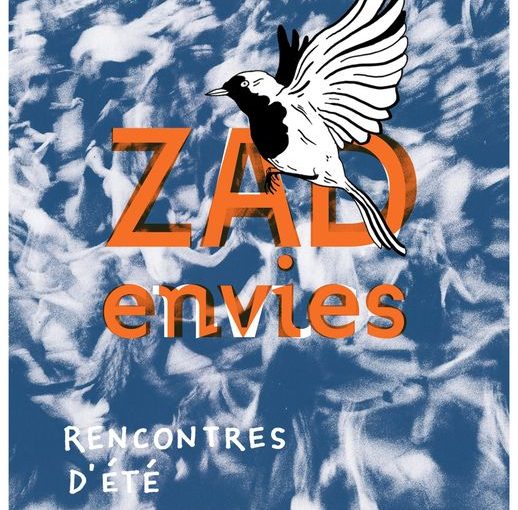Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Le BMC est fondé en 1933 dans la ville de Black Mountain, près d’Asheville en Caroline du Nord, sur le campus d’un camp d’été YMCA.
C’est un projet instigué par l’enseignant John A. Rice (1888 – 1968), suite à son renvoi du Rollins College en Floride sanctionnant ses prises de position marquées à l’encontre de la direction et des orientations stratégiques de l’institution. Considéré comme véritable réformateur de l’éducation, c’est un personnage controversé, notamment du fait de ses critiques véhémentes envers l’éducation supérieure aux Etats-Unis.
Il est accompagné dans cette aventure par Theodor Dreier (le neveu de Katherine Dreier, fondatrice de la Société Anonyme, un musée expérimental d’art moderne, précurseur du MOMA). C’est par l’intermédiaire de Theodor que le collège gagne l’accès à un réseau de généreux donateurs qui rendront possible cette expérimentation. Ce dernier apporte également au collège une dimension holistique, un intérêt pour les façons de vivre et de s’organiser dans un monde en transformation.
La naissance du Black Mountain College répond au désir de créer un nouveau type de collège basé sur les principes de l’éducation progressive tels qu’établis par le philosophe et psychologue américain John Dewey, avec lequel John A. Rice se lie d’amitié dans les années 30. Visant à donner aux individus les moyens et le caractère nécessaires pour participer activement à la vie publique et sociale, le collège s’organise autour de la participation active des étudiants à leur propre formation.
La création du BMC peut également être lue comme l’ouverture d’un espace-temps en résistance face aux événements qui marquent l’époque : la grande dépression qui touche alors de plein fouet les Etats-Unis, l’ascencion d’Adolf Hitler, la fermeture de l’école du Bauhaus en allemagne (sous la pression nazi), le début des persecutions à l’encontre d’artistes et intellectuels en Europe,… dont certain parmi eux trouvèrent d’ailleurs refuge au BMC, que ce soit en tant qu’étudiants ou membres de la faculté, et influencèrent fortement les enseignements et la vie de l’école.
Bien que le BMC ait accueilli tout au long de son histoire de nombreux artistes et enseignants issus du monde de l’art, le collège n’est pas pensé comme une école d’art, mais plutôt comme un espace d’éducation interdisciplinaire. Dès sa fondation il s’agit de créer une école qui oeuvre à effacer les distinctions entre les activités scolaires, périscolaires et extra-scolaires. Une école qui considère l’éducation et la vie comme hautement entremêlées, et qui place les arts au centre plutôt qu’aux marges de sa pédagogie.
Parmi les figures qui ont marqué l’histoire du collège, on peut noter : Josef Albers*, Max Steins, John Cage, Buckminster Fuller, Aldous Huxley, Henry Miller, Merce Cunningham…
Lorsqu’il ouvre ses portes en 1933, le collège compte 21 étudiants, et, au plus fort, en accueillera près d’une centaine, qui deviendront, pour partie, des personnalités parmi les plus influentes dans les champs de la littérature, de la performance, ou encore des arts visuels. Le BMC se fait rapidement connaître au niveau national comme un lieu où s’expérimentent des idées innovantes concernant les objectifs et les moyens de l’éducation supérieure aux Etats-Unis.
L’expérimentation et l’expérience – expérience de la création, effort artistique, apprentissage expérientiel,… – sont donc au cœur des enseignements au BMC. Le cursus comprend l’étude des “arts libéraux” traditionnels – la littérature, la biologie, les mathématiques, les langues étrangères, les arts dramatiques, la musique, les arts visuels, etc. – tout autant que la participation au fonctionnement opérationnel du collège et à la vie de la communauté, – incluant le travail coopératif tel que le maraîchage, la construction et le rénovation, le ménage, la lingerie et la cuisine – ainsi que la vie culturelle du collège avec l’organisation de soirées thématiques, de performances, concerts, etc.
Ainsi, la pratique de la démocratie y occupe une place prépondérante – plus qu’un concept, c’est un mode de vie. L’institution est dotée de statuts uniques (pas de différenciation entre enseignants et étudiants), ainsi les étudiant.e.s participent à toutes les décisions du collège.
Au BMC, la démocratie signifie “faire des choses ensemble”, au-delà de l’administration ou de la gouvernance, il s’agit de faire l’expérience de créer, construire, voir, etc. – collectivement.
Sur le plan de la pédagogie pratique, il n’y a pas d’évaluations notées, ni de cours obligatoires, de curriculum pré-défini, d’examens standards ou de méthodes d’enseignement imposées. La responsabilité de l’éducation est entre les mains des étudiant.e.s, qui décident à leur rythme de leur passage de la division ‘junior’ à la division ‘senior’.
Le diplôme s’obtient après avoir réussi, ce que le premier catalogue du collège décrit comme “l’examen complet du succès ou de l’échec d’un étudiant à assumer ses responsabilités.”. Ces examens faits sur mesure avaient lieu sur demande — seulement lorsque les étudiants se sentaient prêts (ce qui explique que très peu d’entre elleux seront jamais diplômés du BMC) — et se présentaient sous la forme d’une série de questions diverses telles que : “Qu’avez-vous appris de notre étude des feuilles d’automne ?”; “Que pensez-vous qu’il doive être fait du Negro problem aux Etats-Unis ?”; “Si vous deviez concevoir la couverture d’un piano, quels facteurs auriez-vous à considérer ?”; “De quoi pensez-vous que nous rirons dans 20 ans que l’on prend tout à fait au sérieux aujourd’hui ?”. Evidemment, de telles questions ne cherchaient pas à valider des connaissances précises mais bien la capacité des étudiant.e.s à mobiliser perspicacité, réactivité, créativité et pensée critique avec équanimité et introspection, que ce soit pour concevoir une étude de couleurs, discuter de droits politiques, ou encore organiser les plants dans un jardin,…
En 1940, John A. Rice démissionne à la demande de la faculté du collège, à nouveau rattrapé par sa personnalité clivante qui divise et polarise le corps enseignant. S’ouvre alors une deuxième période, marquée par le déménagement du BMC sur un nouveau site, et la conception et construction de nouveaux bâtiments qui seront par la suite reconnus comme une véritable collection du style architectural international aux Etats-Unis.
C’est à la fois une période difficile – du fait du poids des importants travaux sur la vie communautaire – et une période féconde. En effet, le nouveau campus élargi accueillera de nombreux évènements de l’avant-garde comme par exemple le premier dôme géodésique de grande taille construit par Buckminster Fuller avec ses étudiant.e.s; la création de la compagnie de danse de Merce Cunningham ou encore la première performance musicale du compositeur John Cage.
Bien que plébiscité et soutenu par de plusieurs figures clés de la scène américaine telles que l’architecte Walter Gropius, le poète Charles Olson, ou encore les artistes américains Willem et Elaine de Kooning, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Robert Motherwell et Franz Kline; le Black Mountain College est contraint de fermer ses portes en 1957 du fait de difficultés financières.
Ce que l’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité
« What you do with what you know is the important thing. To know is not enough »
— “Ce que l’on fait avec ce que l’on sait, c’est celà qui importe. Savoir n’est pas suffisant.”
~ John A. Rice, article paru dans Harper’s en 1937
Les principes clés qui sont mis à l’oeuvre au BMC sont :
- la centralité de l’expérience artistique comme soutien à l’apprentissage dans n’importe quelle discipline
- la valeur de l’apprentissage expérientiel
- la pratique d’une gouvernance démocratique partagée entre la faculté et les étudiant.e.s
- la contribution aux activités sociales, communautaires et culturelles en dehors de la salle de classe
- l’absence de supervision ou de comptes à rendre à des administrateurs externes (ou institutionnels)
On retrouve dans la pédagogie du BMC certaines des intentions partagées par les Reprises de Savoirs comme par exemple le refus du dualisme entre l’expérience vécue et les matières enseignées (à la manière de Dewey), qui se traduit par un entremêlement entre les activités de subsistance, l’organisation de la vie en communauté et celle des temps d’étude et d’expérimentation.
On peut noter aussi la volonté de rompre avec un système éducatif “sanctionnant”. Ainsi, pour John A. Rice, un des fondateurs du collège, la qualité de l’éducation ne se mesure pas par des notes ou tout autre critère standardisé mais par l’augmentation du désir d’apprendre et questionner; et donc du développement chez les étudiants d’une aptitude à la résolution de problèmes variés, ainsi qu’à un sens de soi plus riche. Ainsi, les examens proposés au collège (détails ci-dessus) visent essentiellement à tester la capacité des étudiants à s’engager avec imagination dans les enjeux – philosophiques, sociaux et pratiques – auxquels nous sommes confrontés dans notre société contemporaine. Rice le résume ainsi : au Black Mountain College, “notre effort central et constant est d’enseigner la méthode, et non pas le contenu; d’insister sur le process et non les résultats; d’inviter les étudiants à prendre conscience que la manière d’appréhender les faits et de se situer par rapport aux faits est bien plus important que la nature des faits eux-mêmes.”
Enfin, la place centrale des pratiques artistiques et expérimentales contribue également à déployer un autre rapport au monde, d’autant qu’elles sont organisées de manière à stimuler et généraliser la coopération (et non la compétition) et orientées vers l’établissement d’un dessein commun face aux périls auxquels l’humanité est confrontée, et le développement d’une capacité démocratique individuelle et collective pour le mettre en oeuvre.
–
*Josef Albers était professeur au Bauhaus et invité par le BMC à la fermeture de ce dernier sous la pression nazi. Il enseigne au collège de 1933 à 1949, où il fait de son objectif pédagogique “to make open the eyes” (ouvrir les yeux) de ses étudiants. Il a contribué à mettre l’éducation à la perception visuelle au cœur du curriculum du collège.
En savoir plus
John A. Rice (1888–1968) – Black Mountain College, Life as a Writer – Students, Education, University, and Faculty – StateUniversity.com https://education.stateuniversity.com/pages/2369/Rice-John-1888-1968.html#ixzz7gZo0i3x6
The Black Mountain College Museum + Arts Center
Black Mountain College : a progressive education – Yale University Press
Leap Before You Look: Black Mountain College, 1933–1957